Cet article est également disponible en : English
Hello. Un nouvel article paru il y a quelques mois dans Road Trip Magazine. Histoire de vous convaincre de l’acheter… important pour permettre à la presse écrite de continuer à vivre 😉
« STOP, FINISH, OVER !! ». J’en ai marre, je hurle et de colère fracasse une chaise sur le mur du poste de police devant le regard médusé des Levies. Les Levies ce sont un peu les gendarmes du Baloutchistan : une force armée traditionnelle chargée du maintien de l’ordre et de la lutte anti-terroriste dans cette région reculée du Pakistan, voisine de l’Afghanistan. Ils assurent ma protection depuis la veille. Le commandant du poste alerté arrive et se dresse devant moi, le doigt levé en signe d’avertissement…
En quittant Bandar Abbas quelques jours auparavant, je savais que je m’engageais pour un parcours de 3000 km dans ce que les diplomates appellent la « zone rouge », formellement déconseillée par le gouvernement Français et où, je cite, « les voyages sont proscrits ».
Pourtant, en allant vers Chebahar, ville balnéaire et portuaire à l’extrême sud-est de l’IRAN, non loin de la frontière Pakistanaise, j’ai plutôt l’impression de m’enfoncer dans un univers de gentillesse et d’hospitalité. De fait, j’ai de plus en plus de mal pour arriver à payer quoique ce soit. Le fameux T’aarof iranien poussé à l’extrême. Le T’aarof, ces règles de courtoisies Iranienne, je commence à en avoir l’habitude : l’hôte doit offrir, l’invité (moi en l’occurrence) doit refuser. Celui qui insiste le plus gagne. Au Baloutchistan, malgré mes protestations réitérées, je n’arrive à rien payer : mes courses, mes repas et même une fois mon plein d’essence me sont quasiment systématiquement offerts.
Je reste quelques jours à Chabahar. Le soir, je vais parfois dans un cinéma plein air déguster un thé tout en regardant des films coréens doublés en farsi. Autant dire que je n’y comprends rien, mais ce n’est pas grave, j’apprécie l’instant en compagnie de quelques pêcheurs. Leurs magnifiques bateaux de pêche en bois attendent dans le port de repartir en mer. Les campagnes de pêche durent deux mois et les mènent jusqu’aux abords des côtes africaines. Je rêve un instant d’embarquer avec eux afin de gagner l’Afrique, mais ils restent dans les eaux internationales sans jamais débarquer. L’aventure s’avère impossible et je reprends donc la route vers le Nord afin de gagner le Pakistan.
L’ambiance commence à changer à Iran Shahr, grosse ville en plein cœur du Baloutchistan Iranien. Pour y arriver, une très bonne route, trop bonne, les automobilistes y roulent vite et n’hésitent pas à doubler alors que vous arrivez en face : une moto cela doit laisser la place. A l’entrée de la ville, pour la première fois depuis que je suis en Iran, la police m’arrête. Ils sont tous armés jusqu’aux dents, certes amicaux mais très surpris de me voir, inquiets même. L’un deux me lance en me laissant partir : « faites très attention dans cette ville ». Le ton de sa voix me met en alerte. La ville à proprement parler est spacieuse mais relativement peu peuplée. En revanche, il y a des hommes en armes partout. Le moindre bâtiment officiel est surmonté d’une tour de contrôle. J’aperçois des fusils mitrailleurs sur plusieurs toits. Une partie de la ville est bloquée par des bus placés en travers des rues. L’armée et la police sécurisent le périmètre. Pourquoi ? Je l’ignore. L’unique hôtel de la ville est fermé, depuis pas mal de temps semble-t-il. Je décide de ne pas m’attarder. Je fais le plein au marché noir, ici l’essence est rationnée pour éviter la contrebande vers le Pakistan, puis je reprends la route vers les montagnes. Je m’y sens plus en sécurité et je passe la nuit dans la maison d’un paysan.
Le lendemain, je passe la frontière. Cela fait plus de deux mois que je suis en Iran, et alors que jusqu’à présent j’ai pu circuler librement, du côté Pakistanais, je le sais, je serai placé sous escorte.
Au cœur du Baloutchistan Pakistanais.
Un membre des Levies me prend en charge avant même la fin des formalités douanières. L’homme, d’une quarantaine d’année, juché sur une simple moto de 125 cc, m’amène directement dans un petit fortin situé à quelques centaines mètres à peine de la frontière. L’ensemble est constitué de quatre bâtiments dont les murs gris et hérissés de barbelés entourent une cour carrée dans un coin de laquelle, inattendu, un petit jardin a été aménagé afin d’améliorer le quotidien des militaires en poste. Un côté de l’ensemble est constitué de cellules, dont les portes en acier semblent être, avec le jardin, les seuls éléments entretenus. En face, les bureaux et la pièce à vivre. Le troisième coté constitue les habitations. En face des chaque cellule de solides anneaux fichés dans le sol servent visiblement à y passer des chaines. L’absence de rouille indique qu’ils sont encore régulièrement utilisés. Le soir, un des militaires m’appelle pour le diner. Je prends place au milieu d’eux. Le repas est frugal mais bon. On mange avec la main droite, comme dans la plupart des pays musulmans. Puis, c’est le thé. Je m’allonge paresseusement dans un coin de la pièce, adossé à une sorte de gros coussin et tout en sirotant mon verre, j’observe ce qui constitue le quotidien de mes gardiens.
A l’entrée, huit paires de chaussures, dont les miennes. Nous sommes quatre. Au moins, ne manquerons-nous pas de souliers. L’officier près de moi a le nez plongé dans son portable. Ici comme ailleurs, la nomophobie fait des ravages. L’homme près de lui, fait chauffer le thé sur une sorte d’appareil électrique servant tout à la fois de chauffage et de foyer de cuisson. Sur une table basse poussiéreuse, le long du mur en face de nous, une vieille télévision cathodique, écran de 36 cm tout au plus, diffuse un film de Bollywood dans lequel des voitures défoncent des piliers de parking souterrain sans même une éraflure. Le troisième homme est assis sur l’unique chaise de la pièce. A côté de lui, posé le long du mur, un fusil mitrailleur « waterproof » comme il me l’a dit fièrement un peu plus tôt dans la soirée. Entendez par là qu’il continue son œuvre de mort même après avoir été dans l’eau. Il est de fabrication chinoise. Les murs sont bleu. Enfin un jour, ils ont été bleu. Sur le sol, trois tapis aux couleurs délavées et en piteux état : un bleu, un mauve et un grand violet et blanc. C’est le plus propre, enfin le moins sale plutôt. C’est également celui sur lequel je suis allongé. Au plafond, un vieux ventilateur. Sur le mur à ma gauche, deux clous où sont suspendus une vareuse et une casquette. En face de moi, au-dessus de la télévision, de vieilles planches font office de carreaux. En fait, tout est en déliquescence ici. Tout sauf une chose : l’humanité. La gentillesse, l’hospitalité de mes cerbères est exemplaire et la soirée se prolonge assez tard.
Le lendemain, c’est le départ. 650 kilomètres nous séparent de Quetta, soit deux jours de route normalement. Dehors, c’est la tempête. Un vent de sable balaye le désert. Je sens que cela ne va pas être une partie de plaisir. Le convoi s’ébranle. Une voiture avec trois hommes à bord : le chauffeur et deux hommes en armes. Je les suis avec Utopia. Ils ne font que quelques kilomètres : à chaque poste de contrôle on relève mon identité, l’immatriculation de la moto et une autre équipe me prend en charge. Les contrôles succèdent au contrôles. Lentement, les kilomètres défilent. Le vent souffle. Par moment, je n’y vois pas à plus de quelques mètres, comme dans le brouillard. Mais point d’humidité ici : seulement du sable. Curieusement, je ne sens ni la fatigue, ni la faim. Tout juste aurons-nous un arrêt afin de boire un thé préparé par un vieil homme hilare, dans une cahute en pierre dans laquelle il faut se courber afin d’y entrer. Lui également a un fusil mitrailleur « waterproof ». Et des lunettes de soleil cassées. La journée s’allonge, le vent fini par se calmer. Mais la nuit vient. J’ai hâte d’arriver à l’étape du jour, afin de vérifier l’état du filtre à air. Et de me reposer aussi, tout simplement. Mais loin de s’arrêter, le convoi continu. Le rythme s’accélère même. Je n’ai même plus le temps de souffler au contrôle : une voiture attend, arrêtée sur le bas-côté et démarre lorsque l’on arrive. A chaque fois, je dois suivre la nouvelle escorte. J’essaye de savoir combien il reste de kilomètre à faire. Cela fait déjà près de 11 heures que je roule, la nuit est tombée et je commence à sentir la fatigue. A chaque fois, la réponse est la même : bientôt. Puis comme je me fais pressant, on me dit 50 kilomètres. Je proteste, le chiffre tombe à 15. Pas « fifty » mais « fifteen », j’ai mal compris me disent-ils. Mais les kilomètres défilent encore et encore. A l’un des contrôles, j’ignore totalement combien j’en ai passé depuis le matin, je déclare ne plus vouloir continuer. Cela plus de plus d’une heure que l’on me promet que l’étape va être dans cinq minutes et je n’en peux plus. Je commence à réaliser que l’étape c’est Quetta. Mais l’homme en charge du contrôle me répond abruptement que ce n’est pas possible. C’est à cet instant précis que j’explose, colère mi feinte, mi réelle. Et je fracasse la première chose qui me tombe sous la main, une chaise, contre le mur du poste de police. Ils en restent tous médusé. Le commandant vient. On s’explique. Ils me disent que dans ce poste, ce n’est pas possible mais que le prochain fortin des Levies est tout proche. Je pourrai y passer la nuit. Nous reprenons la route mais cette fois, ils ne m’ont pas menti. Lorsque je stoppe enfin la moto, cela fait près de 12 heures que je roule. Le compteur journalier affiche 576 km et Quetta n’est plus qu’à quelques dizaines de kilomètres.
Le fortin est dans le même état de décrépitude que le précédent. Il n’y a même pas d’électricité : on s’éclaire à la bougie et à la lampe torche. Le commandant me demande pourquoi je ne voulais pas continuer. Je lui explique que je suis sur la moto depuis près de douze heures. J’ai quitté Taftan, la ville frontière ce matin. Normalement, l’étape est à mi-parcours.
La pièce dans laquelle on me fait entrer est petite mais chauffée. Il y a le commandant et quatre de ses hommes : son cuisinier et trois de ce qu’il appelle ses « gun-men ». Comme à Taftan, je remarque qu’aucun ne fait 10 mètres sans prendre son arme avec lui, y compris à l’intérieur des bâtiments. Tout le monde s’assied par terre. Dans un coin, un petit poêle à bois sur lequel est posé une grosse marmite. Les effluves qui en émanent me font saliver. J’ai faim ! Le commandant parle l’anglais, cela facilite les choses. Je suis assez curieux de connaître l’état réelle des problèmes sécuritaires.
La région est prise en étau entre les indépendantistes baloutches et les talibans venus de l’Afghanistan tout proche. La situation, me confie-t-il, s’est nettement améliorée depuis 3 ans. Il n’empêche que lors des dernières élections en juillet 2018, deux attentats à la bombe on fait près de 200 morts. Douze Levies ont été tué sur ces dernières années lors d’escarmouches avec des rebelles. Je sais par ailleurs que le Pakistan occupe une triste cinquième position pour ce qui concerne les pays les plus impactés par le terrorisme, juste derrière l’Irak, l’Afghanistan, le Nigéria et la Syrie[1]. Mais le mystérieux plat en train de cuire depuis mon arrivée sur le petit poêle à bois est prêt. Le cuisinier, précautionneusement, détache le couvercle qu’il avait scellé avec une sorte de pâte à pain. A l’intérieur, un lièvre, chassé par l’un des gun-men, y a cuit sur une croute de sel agrémentée d’épices et de diverses herbes. La discussion dérive sur un sujet moins grave mais plus essentiel : la famille. L’un des gun-men, un géant, me confie avoir 14 enfants de 3 femmes. Ici le nombre d’enfant, c’est une fierté, presque une compétition. Plus on en a, mieux c’est. Des garçons bien sûr. Les filles c’est moins important. Conviction que partage beaucoup de sociétés traditionnelles. Après le repas, un dernier thé, la conversation s’allonge, avec la confiance viennent les confidences, les échanges de photos. La fatigue de la journée s’est envolée et il est tard dans la nuit lorsque je rejoins enfin le dortoir commun. Mais n’allez pas imaginer qu’on y dort sur un lit. Non, juste un tapis et une couverture pour se protéger du froid. Je m’allonge aux côtés d’un gun-man qui s’endort aussitôt dans un concert de ronflements. Dehors, un de ses collègues monte la garde. Ils se relaieront durant la nuit. Tel est le quotidien des Levies.
Demain, je reprendrai la route. Demain, ce sera Quetta. L’une des villes les plus impressionnantes qu’il m’aura été donné de voir dans ma vie avec Lagos au Nigéria. Mais demain est un autre jour. Demain n’existe pas encore. Le vent recommence à souffler. Je m’endors à mon tour.
Remerciements : je tiens à remercier l’ensemble des forces armées Pakistanaises qui ont assuré par sécurité durant mon séjour, ainsi que le gouvernement pour la mise à disposition, gratuite, de ces escortes.
[1] J’apprendrais quelques jours plus tard, qu’un attentat à la bombe a fait 27 morts sur une route dans le Baloutchistan Iranien 2 jours après mon passage.

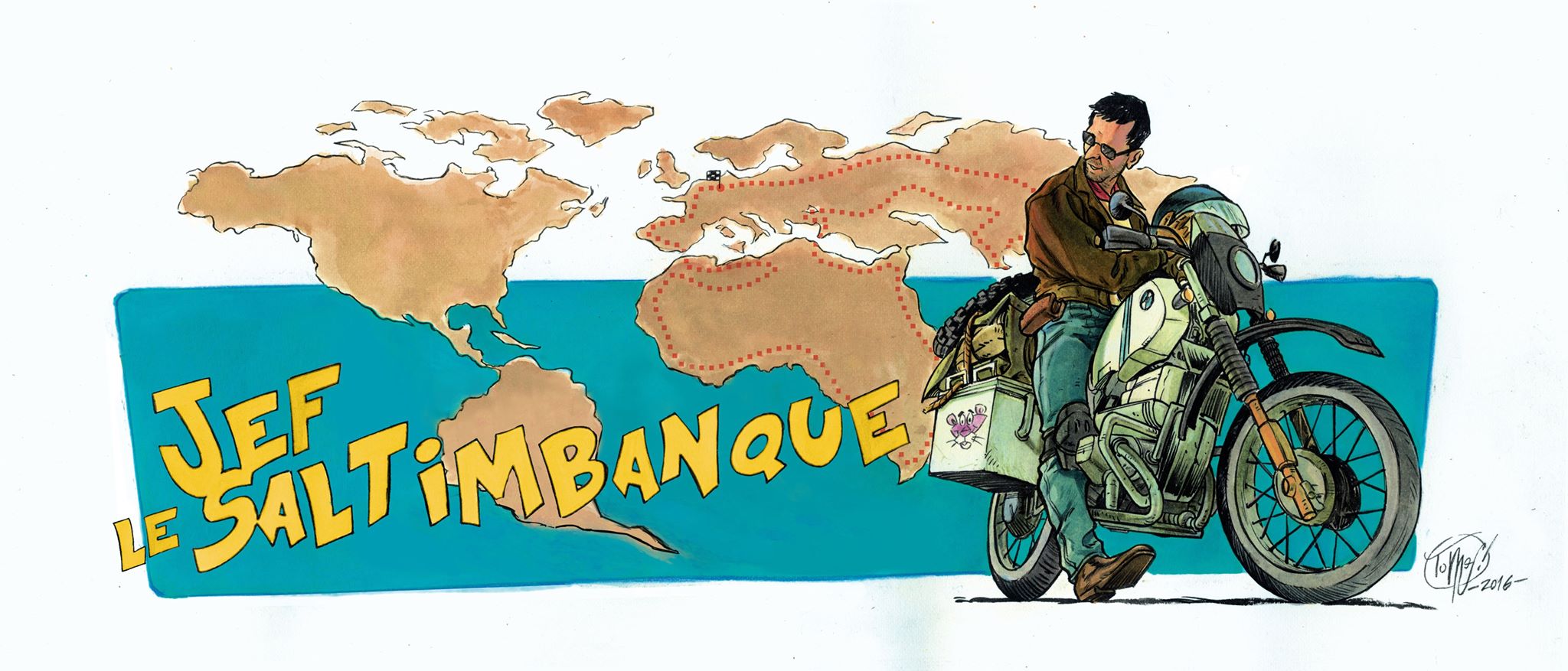


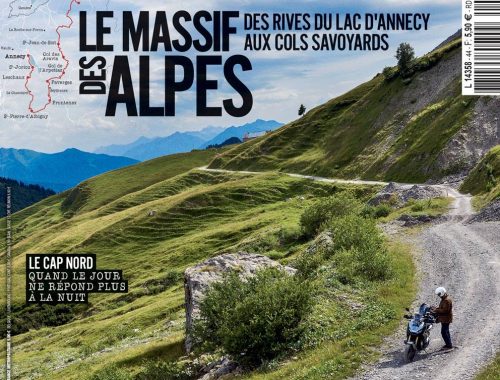

No Comments